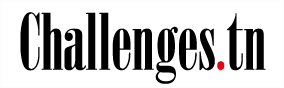Le réalisateur tunisien préside les Journées cinématographiques de Carthage (21-28 novembre). Sans craindre les moralisateurs, il défend des films indépendants et audacieux.
S’il est une figure du cinéma qui fait consensus, c’est bien celle de Brahim Letaief. Né en 1959 à Kairouan, en Tunisie, ce réalisateur est venu au septième art après des études en sciences de la communication, à Paris. Sa génération se réclame des anciens tout en pariant sur une cinématographie nouvelle, ancrée dans la réalité politique et sociale sans dédaigner le grand public. À son actif, de nombreux courts-métrages à la facture tragicomique, dont Visa, qui le fait connaître en 2004 et décroche le Tanit d’or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC). Ou Demain je brûle, une œuvre prémonitoire sur le désespoir de la jeunesse sous Ben Ali et son attirance pour l’émigration clandestine.
Dans Cinecitta, son premier long-métrage, il narre les mésaventures d’un réalisateur aux prises avec le comité d’aide financière de son ministère de tutelle. C’est que Letaief connaît les coulisses du cinéma local comme sa poche et dénonce depuis des années ses failles structurelles. Un aspect qui a sans doute pesé dans sa nomination à la tête de la 26e édition des JCC, du 21 au 28 novembre, à Tunis.
Ce cinéaste enclin à l’optimisme et à la joie de vivre à la tunisienne voit dans sa mission un « défi grand et exaltant »
Brahim Letaief le sait : face à un contexte plombé par la crise économique et la menace terroriste, il doit tenir compte des courants islamistes tout en ménageant la veine moralisatrice qui a remplacé la censure politique de jadis.
Mais ce cinéaste enclin à l’optimisme et à la joie de vivre à la tunisienne voit dans sa mission un « défi grand et exaltant ». Et résume son ambition en trois mots : « dialoguer, rêver, avancer ». Il ose ainsi inclure dans la programmation Much Loved, le film de Nabil Ayouch jugé sulfureux et censuré au Maroc. Il organise même des projections dans les prisons – une première. Qui dit mieux ?