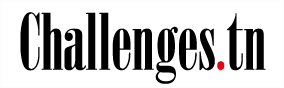Maurice Obstfeld dresse le bilan de son mandat en tant que chef économiste du FMI
Àl’heure de prendre congé, fin 2018, de ses fonctions de chef économiste du Fonds monétaire international, Maurice Obstfeld nous livre sa pensée sur les tensions commerciales, le creusement des inégalités, l’importance de l’éducation et les relations entre les États-Unis et la Chine, dans un entretien avec notre journaliste Gita Bhatt. Maurice Obstfeld compte retourner à l’université de Californie, à Berkeley, où il s’est distingué comme professeur d’économie pendant 24 ans, rédigeant notamment deux manuels qui ont fait date dans le domaine de l’économie internationale. C’est Gita Gopinath, de Harvard, qui lui succédera au FMI.
Quelles sont vos principales préoccupations sur le plan macroéconomique ?
Ces préoccupations sont présentées clairement dans les Perspectives de l’économie mondiale : les tensions commerciales et l’ajustement à des conditions financières hétérogènes, dans un contexte caractérisé par un taux d’endettement privé et public bien plus élevé que par le passé. À plus long terme, la croissance des salaires et de la productivité pose problème. Comment stimuler l’innovation ?
Nous devons revoir en profondeur la façon dont nous abordons l’investissement dans l’éducation, partout dans le monde. Il a été démontré qu’investir dans le capital humain dès le plus jeune âge est essentiel pour assurer la réussite future. Mais, même à l’âge adulte, l’investissement dans le capital humain peut contribuer à une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre, prolonger la vie active et compenser les effets du vieillissement démographique.
Ce type d’investissement permettra également d’atténuer certains problèmes d’ajustement qui pourraient être imputables à la technologie et au commerce international. Il renforcera la résilience des pays, qui seront davantage en mesure de régler un problème crucial et persistant : les travailleurs ne récoltent manifestement pas les fruits de la croissance. Dans de nombreux pays, les citoyens ont aujourd’hui l’impression que le revenu des travailleurs stagne, que la mobilité sociale n’est plus ce qu’elle était, que leurs possibilités sont restreintes, et que leurs enfants n’auront pas une vie meilleure — au contraire. Ces tendances empoisonnent le paysage politique.
Les États-Unis et la Chine sont les plus grandes puissances économiques du monde, et les plus dynamiques. Comment envisagez-vous l’évolution de leurs relations économiques ?
Leurs désaccords vont bien au-delà de l’économie ; ils portent fondamentalement sur la question du leadership mondial. Mettez-vous à la place des États-Unis : vous êtes la première puissance mondiale et vous avez façonné la structure de gouvernance internationale. Comment gérez-vous cette relation, qui offre des possibilités de coopération, mais présente également des risques de conflits ?
En outre, comment comptez-vous vous y prendre, face à un système extrêmement différent du vôtre sur le plan politique ? Dans ses relations commerciales avec la Chine, l’administration Obama s’appuyait sur un élément important, l’accord de partenariat transpacifique, qui excluait la Chine, mais laissait aux pays qui le souhaitaient, dont la Chine, la possibilité d’y souscrire s’ils en respectaient les règles. Cette stratégie visait à maintenir l’influence des États-Unis et à peser subtilement sur l’orientation de la politique commerciale de la Chine.
La relation entre les deux pays paraît aujourd’hui bien plus conflictuelle, tout au moins en matière de commerce extérieur. Je ne suis pas convaincu que cette confrontation soit payante à terme, car elle consacre l’idée qu’un seul pays doit « gagner » et dominer les autres, à l’opposé d’une structure permettant aux pays de coexister et de maîtriser leurs différends.
Pendant ces trois années au poste de chef économiste du FMI, qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans l’évolution de l’économie mondiale ?
Quand je suis arrivé, la Chine venait de dévaluer le yuan et de modifier son régime de change, et les marchés des actifs étaient en proie à une grande agitation. Il s’en est suivi une période d’inquiétude quant à la croissance et la stabilité de la Chine, qui a affecté les marchés des actifs internationaux jusqu’au premier semestre de 2016.
La surprise suivante est venue du référendum sur le Brexit, organisé à la mi-2016, à une époque où la nervosité régnait encore sur les marchés, qui n’étaient pas à l’abri des risques. Peu après, c’est l’élection présidentielle aux États-Unis qui a déjoué les pronostics et enclenché une nouvelle dynamique, avec, d’une part, la perspective de nouvelles mesures de relance de l’économie américaine par la voie budgétaire, appuyées par un marché boursier en effervescence, mais, d’autre part, des déclarations fracassantes sur le commerce international et sur la renégociation éventuelle de relations commerciales fondamentales, qui se sont concrétisées environ un an plus tard.
Pendant tout ce temps, la Fed normalisait progressivement sa politique monétaire. Elle a commencé à relever les taux d’intérêt américains en décembre 2015, et, avec chaque nouvelle hausse, nous sommes entrés peu à peu dans une période où les conditions financières se resserrent nettement pour les pays émergents.
Ressentez-vous une certaine responsabilité quant à l’impact que vos recherches ont sur les politiques adoptées ?
J’aspire toujours à la plus grande rigueur et à la plus grande crédibilité dans mes travaux — c’est un gage de sérénité. Il est plus angoissant de devoir donner le juste conseil en situation de crise, en sachant qu’une grave erreur risquerait de causer du tort à de nombreuses personnes. Je n’ai pris la pleine mesure de cette responsabilité qu’en août 2015, juste avant de prendre mes fonctions actuelles. La Chine a dévalué sa monnaie ce mois-là, et les marchés mondiaux ont dévissé. Certains économistes de renom publiaient des tweets alarmés — et alarmistes. Jason Furman, qui dirigeait le conseil économique du président américain, était en congé de paternité, et, en tant que membre de ce conseil, j’étais donc le macroéconomiste responsable. Le président Obama m’a convoqué dans le bureau ovale, aux côtés du secrétaire du Trésor, Jack Lew.
Le président prenait tout cela calmement. Il m’a regardé et m’a demandé : « Est-ce que je devrais m’inquiéter ? » Je me suis dit que je ne m’étais jamais trouvé dans ce genre de situation, mais que cela m’arriverait probablement souvent au FMI. Je n’avais que quelques secondes pour préparer ma réponse, et je lui ai dit : « Non. Les marchés vont reprendre pied et, pour le moment, je ne pense pas que la fin du monde soit proche. » Le président s’est tourné vers le secrétaire du Trésor et lui a demandé : « Jack, qu’en pensez-vous ? » Il a répondu qu’il était d’accord avec moi. « D’accord, merci », a répondu le président. « On peut demander à ces gens d’arrêter de tweeter ? » La réunion était terminée.
Sur quels points estimez-vous avoir changé la donne ?
Le commerce international n’était pas traditionnellement une grande priorité du FMI, mais nous avons vraiment avancé dans ce domaine ; la prise en compte des inégalités et de l’inclusion dans la croissance est devenue bien plus systématique ; et nous travaillons davantage sur les questions de climat. Quand je suis arrivé au FMI, tout le monde n’était pas persuadé de l’utilité de nous pencher sur le climat. Mais, s’il y a bien une menace qui est critique sur le plan macroéconomique, c’est celle-là — on pourrait difficilement faire plus « macro ». Il est naturel pour le FMI de se préoccuper des défaillances de la coordination mondiale, or le changement climatique en constitue l’exemple le plus vaste et le plus lourd de conséquences. Si j’ai contribué un tant soit peu à faire évoluer la pensée du FMI à ce sujet, j’en suis très heureux.
Comment voyez-vous évoluer le rôle du FMI ?
Nous devons intégrer à notre surveillance une perspective à long terme. Nous avons tendance à focaliser notre attention sur le court terme et le moyen terme, mais il est impératif de réfléchir à plus long terme afin de pousser davantage les autorités à envisager l’avenir lointain, bien au-delà du cycle politique. Nous devrons pour cela également élargir le champ de notre réflexion.
Nous devons prendre conscience du fait que nous occupons une position unique : nous sommes une institution dotée d’une longue histoire, qui jouit d’une certaine indépendance des préoccupations politiques au jour le jour. Je pense que nous devons garder à l’esprit la particularité de notre position et apprendre à l’exploiter plus efficacement.